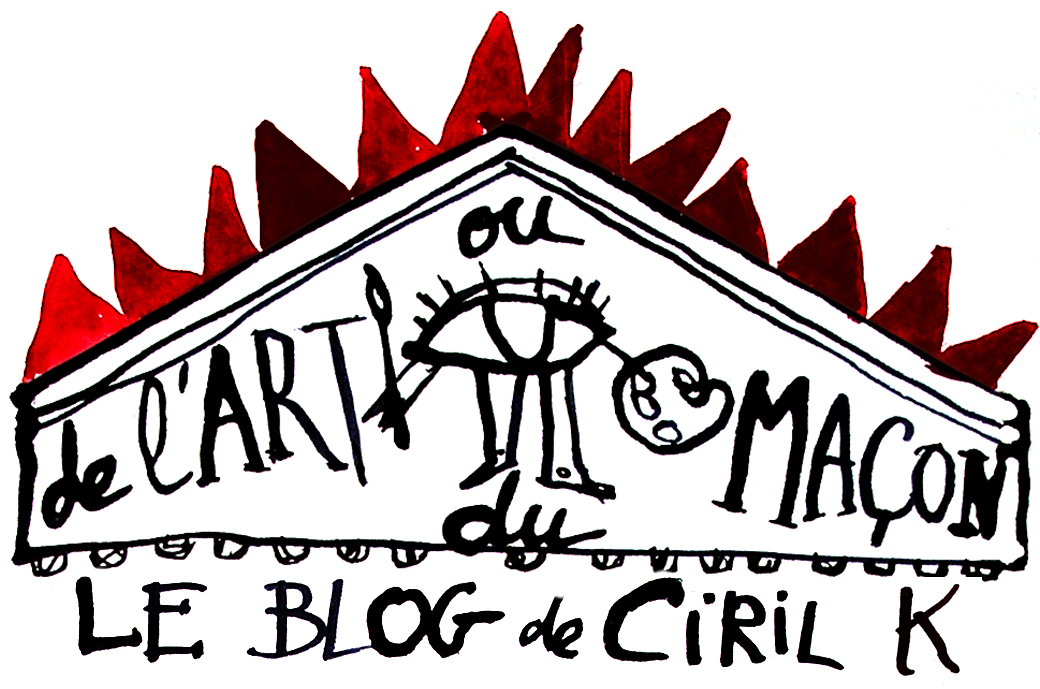|
| Mes soeurs, avez vous reçu de telles lettres d'adieu? Ici de dernier adieu. J'ai le sentiment que l'on a un peu perdu avec le texto... |
Mais, console-toi, veuve
désolée ! l'épitaphe de ton pauvre Camille est plus
glorieuse : c'est celle des Brutus et des Caton, les
tyrannicides. Ô
ma chère Lucile ! j'étais né pour faire des vers, pour
défendre les malheureux, pour te rendre heureuse, pour composer,
avec ta mère et mon père, et quelques personnes selon notre cœur,
un Otaïti. J'avais rêvé une république que tout le monde eût
adorée. Je n'ai pu croire que les hommes fussent si féroces et si
injustes. Comment penser que quelques plaisanteries, dans mes écrits
contre les collègues qui m'avaient provoqué, effaceraient le
souvenir de mes services ! Je ne me dissimule point que je meurs
victime de ma plaisanterie et de mon amitié pour Danton. Je remercie
mes assassins de me faire mourir avec lui et Philippeaux ; et,
puisque nos collègues sont assez lâches pour nous abandonner et
pour prêter l'oreille à des calomnies que je ne connais pas, mais,
à coup sûr, des plus grossières, je vois que nous mourrons
victimes de notre courage à dénoncer des traîtres, de notre amour
pour la vérité. Nous pouvons bien emporter avec nous ce témoignage,
que nous périssons les derniers des républicains. Pardon, chère
amie, ma véritable vie, que j'ai perdue du moment qu'on nous a
séparés, je m'occupe de ma mémoire. Je devrais bien plutôt
m'occuper de te la faire oublier, ma Lucile ! mon bon loulou !
ma poule ! Je t'en conjure, ne reste point sur la branche, ne
m'appelle point par tes cris ; ils me déchireraient au fond du
tombeau : vis pour mon Horace, parle lui de moi. Tu lui diras ce
qu'il ne peut point entendre. Que je l'aurais bien aimé !
Malgré mon supplice, je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera
mes fautes, les faiblesses de l'humanité ; et ce que j'ai eu de
bon, mes vertus, mon amour de la liberté, Dieu le récompensera. Je
te reverrai un jour, ô Lucile ! ô Anette ! Sensible comme
je l'étais, la mort, qui me délivre de la vue de tant de crimes,
est-elle un si grand malheur ? Adieu, loulou ; adieu, ma
vie, mon âme, ma divinité sur la terre ! Je te laisse de bons
amis, tout ce qu'il y a d'hommes vertueux et sensibles.
Adieu,
Lucile, ma chère Lucile ! adieu, Horace, Anette ! adieu,
mon père ! Je sens fuir devant moi le rivage de la vie. Je vois
encore Lucile ! Je la vois ! mes bras croisés te serrent !
mes mains liées t'embrassent, et ma tête séparée repose sur toi.
Je vais mourir !».
Camille Desmoulins à sa femme.